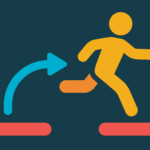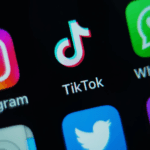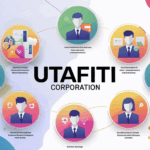Les femmes entrepreneures jouent un rôle de plus en plus central dans l’écosystème tech et social. En 2025, certaines fondatrices de start-up sortent particulièrement du lot par leur vision et leur impact. Suivre ces dirigeantes vous permettra de comprendre les tendances fortes qui animent les marchés. Chacune d’elles apporte une solution innovante à des besoins concrets : santé, finance, éducation ou développement durable. Découvrez cinq parcours inspirants pour vous guider tout au long de l’année.
Fatoumata Ba : simplifier le financement des PME africaines

Fatoumata Ba, cofondatrice de Janngo, a forgé son expertise dans la finance panafricaine avant de lancer une plateforme utilisant l’IA et le mobile money pour faciliter le crédit aux PME. Son algorithme réduit les risques de défaut et a déjà soutenu 10 000 entreprises. Cependant, l’accès reste limité pour les structures informelles, car le modèle dépend de données historiques souvent lacunaires. La dépendance aux réseaux télécoms exclut aussi les zones rurales mal connectées. Malgré ces écueils, son outil incarne une avancée majeure pour l’inclusion financière.
Entrepreneuriat féminin africain : Aïssata LY

Aïssata LY, entrepreneure malienne de 32 ans, dirige la maison de couture « LY’A Mode » et cofonde le concept-store « Univers du Made In Mali », promouvant le textile local. Avec un chiffre d’affaires de 49 millions de FCFA, elle milite pour l’entrepreneuriat féminin comme levier de développement africain. Son modèle valorise le savoir-faire artisanal et vise à industrialiser le secteur textile malien. Cependant, son approche centrée sur le luxe et les marchés urbains pourrait limiter l’accès aux femmes issues de milieux ruraux ou modestes. Malgré ces défis, son leadership inspire une nouvelle génération de femmes à s’emparer des opportunités économiques.
A consulter : Les nouveaux concepts digitaux en management des RH
Mariam Diop – rendre l’éducation plus ludique
Mariam Diop, ancienne enseignante sénégalaise, a créé ÉduGame pour rendre les STEM accessibles via des jeux offline utilisés dans 200 écoles. Sa gamification motive les filles à s’orienter vers les sciences, comblant un manque de modèles féminins. Cependant, l’impact repose sur la formation des professeurs, inégale selon les zones. Les mises à jour des contenus offline sont aussi complexes, risquant un décalage avec les programmes. Malgré ces limites, son modèle reste une arme contre les inégalités éducatives.
Selamawit Worku – un bilan carbone pour chaque produit

Selamawit Worku, ingénieure éthiopienne, a lancé GreenTag pour afficher et compenser l’empreinte carbone des achats en ligne, avec des projets de reforestation. Son initiative promeut une consommation responsable, mais le calcul simplifié ignore des facteurs comme la logistique, facilitant le greenwashing. Les partenariats avec les ONG manquent aussi de traçabilité sur le long terme. Pourtant, sa plateforme éveille les consciences et pousse les marques à plus de transparence environnementale.
Entrepreneuriat féminin africain : Manuela Kouadio
Manuela Kouadio, ingénieure ivoirienne en informatique, pilote depuis 2015 une entreprise spécialisée en infographie et développement. Co-fondatrice de WoMoz Côte d’Ivoire, elle promeut les femmes dans les TIC et l’open source via Mozilla, visant à accroître leur participation dans les projets collaboratifs. Son engagement a renforcé la visibilité des contributrices africaines, mais l’impact de WoMoz reste concentré dans les zones urbaines, avec un accès limité aux femmes rurales peu connectées. L’absence de liens directs entre contributions open source et revenus stables questionne aussi la durabilité du modèle. Pourtant, son travail ouvre des portes dans un secteur tech encore majoritairement masculin, combinant innovation technique et plaidoyer pour l’inclusion.
Femmes entrepreneures : que retenir ?
Ces entrepreneures allient ancrage local et technologies globales, mais leurs innovations révèlent des tensions entre idéal et réalité. Inclusion financière, santé ou éducation : chaque solution doit composer avec des infrastructures défaillantes, des barrières culturelles ou des modèles économiques fragiles. Leur réussite dépendra d’adaptations continues aux contextes territoriaux, rappelant que l’impact durable exige autant de résilience que de créativité. Observer leur évolution en 2025 offrira des clés pour penser l’innovation autrement.